
Portrait des accidents de la route sous l’effet du cannabis
Radio-Canada
D’après le constat de l’équipe de recherche de la Faculté de médecine de l’Université Laval, les accidents reliés à de la consommation d’alcool se produisent davantage la « nuit, pendant la fin de semaine, dans des zones rurales, [...] impliquent un seul véhicule et [...] causent des blessures graves », tandis que les accidents reliés au cannabis « surviennent pendant la journée, un jour de semaine, et [...] impliquent plusieurs véhicules ».
Cela suggère une consommation routinière de cannabis plutôt qu’une consommation récréative dans un contexte spécial, avance un des auteurs de l’étude, Éric Mercier, de la Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval. C’est une grande réalisation et une surprise dans les résultats, ajoute-t-il.
L’équipe de recherche a analysé 7000 accidentés, dont 30 % avaient de l’alcool ou du THC dans le sang. Un échantillon de sang a été prélevé chez tous les patients dans les six heures qui ont suivi l’accident, et ce, dans un des 15 centres de traumatologie qui ont participé à l’étude.
Ces prélèvements ont été faits pour des raisons médicales et non parce qu’on soupçonnait qu’il y avait eu consommation d’alcool ou de cannabis, précise Éric Mercier.
Dans les deux cas de figure, les hommes sont surreprésentés tant dans le groupe avec un taux élevé de THC que dans le groupe avec un taux élevé d’alcool.
Les plus jeunes sont également plus à risque, selon les résultats de la recherche, particulièrement s’ils consomment du cannabis. Un des résultats qui nous ont frappés, c'est que chez les moins de 19 ans, 5 % présentaient un taux élevé de THC, alors qu’à peine 3 % avaient un taux élevé d’alcool, poursuit le professeur Mercier. C’est notre constat le plus alarmant.
Au-delà des résultats, les chercheurs réclament une meilleure prévention quant à la consommation de cannabis, et ce, autant de la part des intervenants médicaux que de celle des autorités gouvernementales.
Des interventions de la sorte ont montré leur efficacité dans le cas de l’alcool, rappelle le professeur Mercier, qui est également médecin urgentologue et chef d’équipe en traumatologie à l’hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec.
La règle du zéro alcool prévue au Code de la sécurité routière pour les moins de 22 ans peut expliquer ce constat [avec l’alcool]. Il faudrait envisager l’adoption d’une mesure similaire pour le THC.

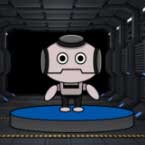 Run 3 Space | Play Space Running Game
Run 3 Space | Play Space Running Game
 Traffic Jam 3D | Online Racing Game
Traffic Jam 3D | Online Racing Game
 Duck Hunt | Play Old Classic Game
Duck Hunt | Play Old Classic Game